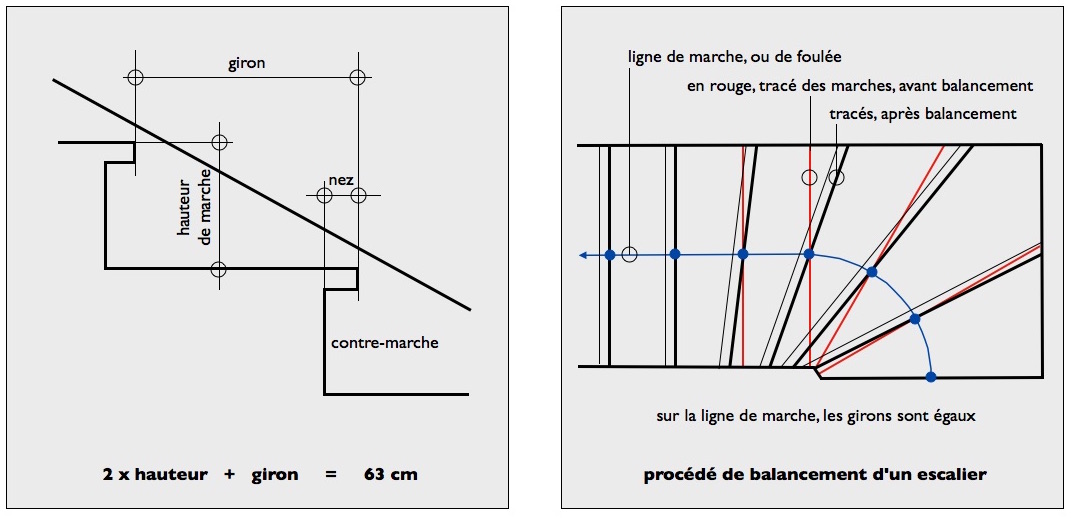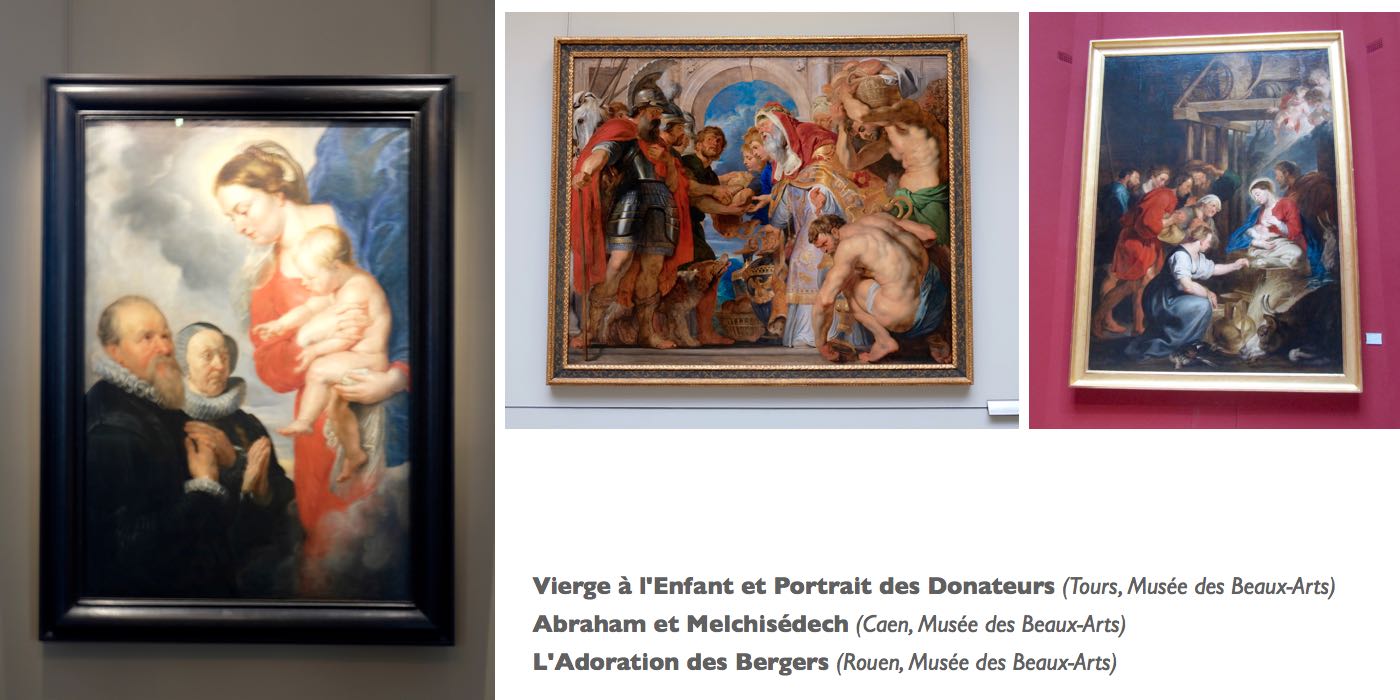(Ceci n’est qu’une miette, une rognure d’un voyage que je viens de faire par huit villes du Nord-Ouest de la France. D’autres textes suivront, et peut-être réunirai-je ensuite l’ensemble dans un texte plus long et complet.)
On dirait que le bûcher, sur lequel Jeanne d’Arc a brûlé le 30 mai 1431 à Rouen, n’est pas tout à fait éteint, que le feu couve encore, car cette dame demeure un sujet conflictuel, pas entre Français et Anglais — ces derniers s’en sont dégagés — mais entre Français et Français, au sujet de la place qu’elle prend dans l’imagerie et l’identité nationales du pays. Je serai donc prudent, car je sais que les sujets abordés ci-après ont parfois fait l’objet de discussions enflammées. Il suffit de souffler sur les braises, si je peux dire.
L’Église catholique, qui en son temps avait tué Jeanne d’Arc, l’a béatifiée en 1909, soit quatre ans après la loi de séparation des Églises et de l’État de 1905, pour la canoniser en 1920 et la déclarer sainte patronne secondaire de la France en 1922 (la Sainte Vierge étant la patronne principale), renforçant ou voulant rétablir ainsi les liens ancestraux entre pouvoirs terrestres et célestes dans l’Église de France. [Ainsi, ce ne sont pas des saints chrétiens mais bien des rois qui dominent les façades des cathédrales gothiques à Chartres, Amiens, Paris et Reims, et on discute de savoir si ce sont ceux de France ou de Judée, les uns étant considérés comme les dignes successeurs des autres.] Pensez Église quand vous dites France, et France quand vous dites Église, telle est l’idée.
Ce statut permet à Jeanne d’Arc d’être célébrée aussi bien dans les rues que dans les églises du pays, et de bénéficier de deux fêtes sur le calendrier, l’une catholique, le 30 mai, l’autre légale, le second dimanche du même mois (certains leur préférant le 1er mai, mais ça c’est une autre histoire). Depuis 1979 une église Sainte-Jeanne d’Arc, inaugurée par le Président de la République Valéry Giscard d’Estaing, occupe la place du Vieux Marché à Rouen, où se trouva le bûcher. Elle y succède à une église Saint-Sauveur, détruite lors de la Révolution, et intègre les vitraux de l’ancienne église gothique Saint-Vincent, située en bas de la ville et détruite en mai 1944 lors d’un bombardement. (Anglais? non, américain). Ces vitraux, sans aucun lien avec l’histoire de Jeanne d’Arc, avaient été mis en sécurité dès 1939 par un Service des Monuments historiques particulièrement prudent.
Ceci dit, en temps normal, avec le marché, les restaurants et leurs grillades, les touristes et les badauds, l’ambiance sur la place et dans l’église est plus à la fête qu’au recueillement. Fût-il religieux ou patriotique.
Caen
La place du Vieux Marché à Rouen n’est pas le seul concentré, ou raccourci, de l’histoire de France, entre Jeanne, Révolution, guerre, Église et République. La place de la Résistance, sur l’avenue du 6 juin [1944], à Caen, l’est presque autant. Car on y trouve cette étonnante statue de Jeanne d’Arc. Ou plutôt: cette étonnante inscription “Oran 1931, Caen 1964” sur le socle d’une statue de Jeanne par ailleurs très conventionnelle, équestre et dorée.

D’ordinaire, c’est ainsi qu’on inscrit les victoires. Je m’attendrais donc plutôt à lire “Orléans 1429”, ou “Patay”, “Saint-Pierre-le-Moûtier”, voire “Reims” ou “Sainte-Catherine-de-Fierbois”. Quelle est donc la bataille d’Oran à laquelle Jeanne aurait pu participer en 1931?
La réalité est plus simple, et plus proche de nous: le cinqcentenaire de la mort de Jeanne d’Arc, également centenaire de la conquête française d’Oran, a été l’occasion d’ériger une statue de l’héroïne devant la cathédrale de cette ville, dans ce qui était alors l’Algérie française. Après l’indépendance de l’Algérie en 1962, qui n’a pu être obtenue que grâce à une guerre contre le colonisateur (“les événements”) et la sagesse du général De Gaulle, alors Président, la cathédrale a été transformée en bibliothèque et la statue déménagée vers Caen, à l’initiative de son maire, anti-gaulliste déclaré.
Ce n’est donc pas pour faire la nique à Rouen, l’autre capitale normande, mais pour célébrer l’Algérie française, que Jeanne d’Arc est présente dans la ville. C’est fou toutes les causes qu’à travers les âges on a demandé à cette jeune femme de porter.
une jolie brunette
Mon étonnement jehannesque ne s’arrête pas là. À quoi ressemblait-elle?
Car si Jeanne d’Arc a été brûlée vive, comme une sorcière, et les cendres jetées dans la Seine, c’était à la fois pour mieux la punir, la torturer, servir d’exemple par l’horreur, que pour éviter qu’il n’en demeure la moindre trace, d’éventuelles reliques qu’on pourrait vénérer.
De Jeanne, il ne reste donc rien, et les descriptions la concernant sont sommaires, parfois même contradictoires, et souvent indirectes. Il n’empêche, des siècles plus tard, le nationalisme et le romantisme aidant, quand le culte de Jeanne a commencé, les artistes ont bien su à quoi elle ressemble. C’est en tous cas ce qui m’est apparu dans la salle qui lui est consacrée au Musée des Beaux-Arts de Rouen. Regardez.

Comme d’autres artistes avant eux, il y a des siècles et des siècles, ont donné au Christ une physionomie qui plaise à leurs commanditaires, les romantiques du dix-neuvième ont peint des Jeanne au goût de leur temps: les cheveux presque noirs, légèrement ondulés, la peau pâle, lisse et immaculée, rougie sur les joues, les yeux grands dans un large visage, le menton fin, et surtout cette innocence du regard, cette apparente fragilité. Une jolie brunette. Avec pour quelques-uns, comme ici Georges William Joy (1895), un irlandais, et surtout Isidore Patrois (1867), une certaine influence, me semble-t-il, des Pré-Raphaelites anglais. Oubliant la statue qu’elle a eue à Oran, d’aucuns ont pu voir dans ces portraits imaginés une justification pour refuser des Jeanne moins blanches.
Je conclus toutefois avec une œuvre différente, également vue dans le musée de Rouen. Une scuplture dont je n’ai pas noté l’auteur, ni l’année de sa création. Un autre visage, et un autre regard, une assurance, qu’elle porte au-delà des spectateurs-admirateurs que nous sommes.

 Le tournant des fauteuils ne me passionne pas particulièrement — ni pour la couleur, ni pour le mouvement — mais il me plaît d’imaginer que cet aménagement disparaîtra, laissant le tableau à son nouvel emplacement.
Le tournant des fauteuils ne me passionne pas particulièrement — ni pour la couleur, ni pour le mouvement — mais il me plaît d’imaginer que cet aménagement disparaîtra, laissant le tableau à son nouvel emplacement. Ce détail, ce traitement pictural de la robe de Marie-Madeleine, est une des raisons pour laquelle je retourne souvent voir ce tableau.
Ce détail, ce traitement pictural de la robe de Marie-Madeleine, est une des raisons pour laquelle je retourne souvent voir ce tableau.