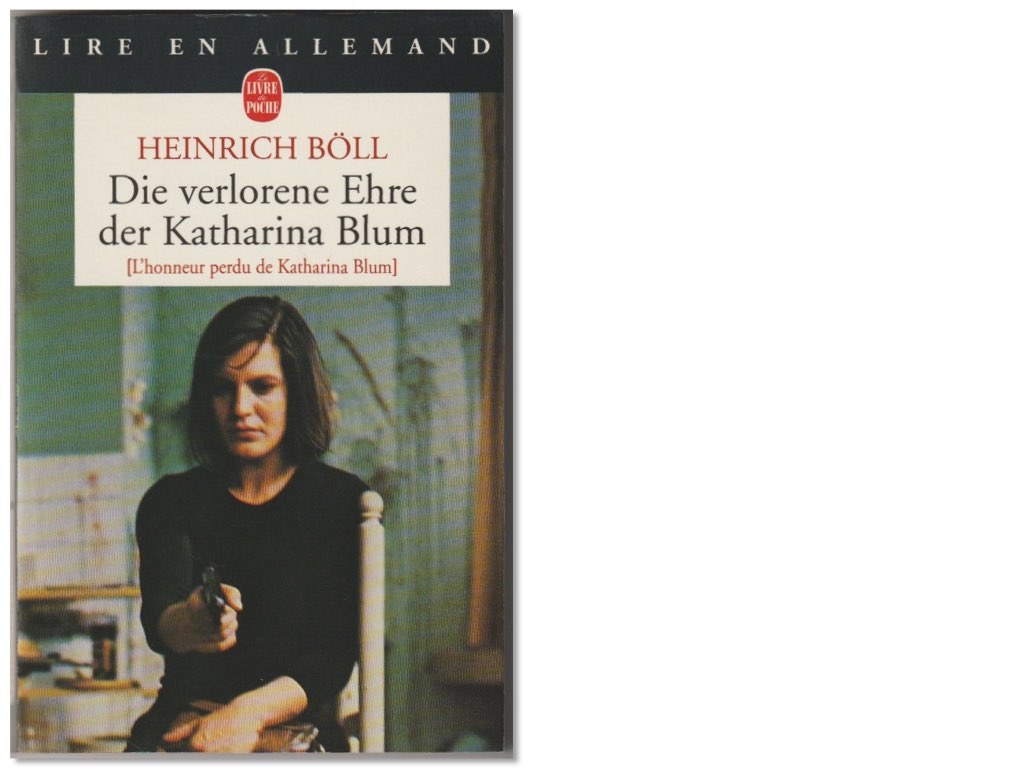“Dans la forêt (Into the Forest) est un roman d’anticipation américain de Jean Hegland, paru pour la première fois en 1996″ peut-on lire sur wikipedia.
Quelques lignes plus loin, le texte poursuit: “Dans un futur proche indéterminé…”
Sur la même page, sous le titre “accueil critique”, se trouve le commentaire de Macha Séry (Le Monde du12 janvier 2017) que le livre est “une dystopie”, l’autrice “ayant fait preuve d’originalité en publiant son livre avant la mode des contre-utopies”. Pour certains, le roman est “survivaliste”.
Tout cela est vrai. Un peu. Pas plus. Car ce roman est d’abord autre chose.
(attention: divulgâcheur)
Alors que je suis à Montréal, ma fille m’a suggéré de lire “Dans la forêt” de Jean Hegland. [Prononcez Jean comme dans jeans.] Je ne peux amener suffisamment de livres dans mes bagages pour les quinze jours de mon voyage — dont toutes les heures dans l’aéroport et l’avion —, tout en anticipant les déceptions qui me feraient mettre de côté un livre apporté de chez moi après quelques pages de lecture. Sa collection peut donc me “dépanner”. Voire plus, car ses avis et conseils me sont précieux.
“Dans la forêt” raconte la vie de deux sœurs adolescentes puis jeunes adultes, habitant une maison dans la forêt en Californie, éloignée de tout — et éloignées de tous — dans un temps, “un futur proche”, où plusieurs catastrophes ont touché la terre — ou seulement l’Amérique? — mettant fin à la distribution d’électricité et à celle de carburant et de produits de consommation dans la ville la plus proche (à 50 km, quand-même). Plusieurs épidémies ont décimé ou fait fuir la population. Il n’y a plus de médecins, ni de services publics, ni même d’impôts. L’autrice ne raconte pas lequel des événements à causé les autres. Car là n’est pas le sujet.
Une des deux sœurs, Nell, écrit son journal, démarré à l’âge de 17 ans, mais comprenant des pages rétrospectives sur les trois années précédentes — le temps où rien ne manquait —, et conclu quelque deux ans plus tard. Sa sœur Eva est d’un an son aînée. Les deux sœurs ont d’abord perdu leur mère, morte d’un cancer, et ensuite leur père, mort d’un accident. (La tronçonneuse, en coupant du bois.)
Bien plus que l’effondrement de la société, de ses règles et de ses technologies, et même plus que la survie dans la forêt, avec la (re)découverte des plantes sauvages ou cultivées (les graines conservées par le père) et celle des animaux, c’est la relation entre les deux sœurs, qui passe par tous les sentiments et attitudes possibles, de l’amour et de la tendresse jusqu’au déni et la volonté de tuer, et leur féminité, qui constituent la matière du livre. L’effondrement et la forêt n’en sont que le contexte. Par son contenu, ce roman féminin est également féministe, et pas seulement “sur certains aspects”. Toutes les pages respirent la fierté d’être femme.
Après la parution tardive de la traduction française en 2017, soit vingt ans après l’original américain et deux ans après le film tiré de l’histoire — alors que d’autres traductions ont paru dès 1997 — certains critiques ont jugé que “le thème du livre n’a rien perdu de son actualité”. À mon avis, il ne la perdra jamais. Car il est éternel. Notamment — mais pas seulement ! — les pages qui traitent de l’enfantement, la gestation, l’accouchement au milieu de la forêt et l’allaitement sont très fortes et très belles. Ce n’est peut-être pas un hasard si Jean Hegland a d’abord publié, en 1991, un livre non fictionnel The Life Within: Celebration of a Pregnancy.
hommes
Les hommes sont présents dans le livre de quatre façons, voire cinq. Il y a le père, enseignant atypique, enseignant aussi de ses filles qu’il refuse d’envoyer à l’école, habitué à la forêt et “collectionneur” de tout — incapable de jeter quoi que ce soit. Il y a le fils d’Eva, le bébé qui naît à la fin du roman — alors que Nell espérait que ce soit une fille. Il y a le violeur anonyme, père (biologique) du bébé, qui est passé à leur maison à la recherche de carburant, et dont les deux femmes craignent le retour tout au long des pages et des saisons. [Qu’y a-t-il de pire? me suis-je demandé tandis que nous courions vers la maison avec nos sacs de baies qui cognaient dans nos dos — un ours ou un homme? (page 234, après la découverte d’empreintes dans la forêt, qui se révèlent être celles d’un ours)] Et il y a l’ami de Nell, Eli, qui a voulu convaincre les deux sœurs, et surtout Nell, de partir avec lui vers l’Est, vers Boston, où (dit-on) l’électricité et l’autorité auraient été rétablies. Nell hésite, mais décide de rester avec Eva, et Eli part sans elles. En cinquième, il y a aussi, dirais-je, les livres, et surtout l’encyclopédie, dont Nell lit des extraits tout au long de l’histoire, et qui lui sert de guide et de manuel — jamais assez précis et concret. [Comme d’habitude, l’encyclopédie ne dit rien sur la façon de s’y prendre. (page 264)] À la fin, les deux filles décident de mettre le feu à la maison, à tous les objets et souvenirs qu’elle contient et à tous les livres, dont cette encyclopédie. Seuls son Index: A – Z, le livre des Plantes indigènes de la Californie du Nord, et un recueil de chants et de récits des humains qui avaient peuplé la forêt avant nous, ainsi qu’un petit nombre d’objets pratiques sont préservés — des couvertures, des couteaux et des casserolles, des brocs, une loupe, et des graines — pour être apportés au plus profond de la forêt, où les deux femmes et leur bébé (oui: leur bébé) s’installeront dans la souche d’un séquoia géant — là où personne (aucun homme) ne risque de les chercher.

Deux femmes à l’enfant, Henry Moore, bronze, 1945, San Diego Museum of Art, vu à l’exposition Georgia O’Keeffe et Henry Moore au Musée des Beaux-Arts de Montréal, mai 2024.
“Moore souligne l’importance de la lecture dans la vie familiale et élargit la définition traditionnelle de la famille en incluant un groupe de deux femmes avec un ou une enfant.”
miroirs
Il y a plusieurs effets de miroir — de miroir déformé, contraste plutôt que symétrie — dans le livre. Entre le père des deux sœurs, et leur fils. Entre le violeur d’Eva et l’amant de Nel, ou entre le rapport sexuel contraint et violent, et celui en tendresse, voulu et vécu à deux. Avec, au centre de ce losange de relations, la sororité, l’amitié, l’amour et l’intimité entre les deux sœurs. Il y a le miroir violent entre l’accouchement dans la forêt et la mise à mort par plusieurs coups de fusil d’une laie (femelle du sanglier) en présence de ses deux marcassins (deux sœurs?), décidée et effectuée avec peine morale autant que physique par Nell pour nourrir sa sœur enceinte. La mort de l’animal doit renforcer la santé de la mère et du futur enfant. Et il y a le miroir entre la vie dans la forêt (voulue par le père) et les ambitions citadines des deux filles. Eva voulait être danseuse à l’opéra de San Francisco et Nell étudier à Harvard, ce qu’elles auraient été capables de réussir. Jusqu’à ce qu’elles doivent abandonner leurs projets.
Sans oublier que le livre démarre avec une fête de Noël, fête de la consommation et des excès: Ça pourrait être mieux, ça pourrait être pire. Mais au moins, il y a un bébé au centre, dit le père (page 11), et reprend sa fille quelques années plus tard, à la fin de l’histoire (page 308).
Puis:
Ma sœur danse donc et la maison morte brûle, et je griffonne ces quelques derniers mots à la lueur de son embrasement. Je sais que je devrais jeter cette histoire, aussi, dans les flammes. Mais je suis encore trop une conteuse d’histoires — ou du moins une gardienne d’histoires —, je suis encore trop la fille de mon père pour brûler ces pages.
Le vent se lève à présent et le bébé se réveille. Bientôt nous traverserons tous les trois la clairière et entrerons dans la forêt pour de bon.
(page 309, la fin du livre, dans la traduction française de Josette Chicheportiche).
Par toutes ces scènes, par tous ces événements vécus par les sœurs, Dans la forêt est également un roman d’initiation et d’apprentissage. Un Bildungsroman. Et (oui, d’accord, aussi, et accessoirement) un retour à la nature. Mais le caractère dystopique et d’anticipation post-apocalyptique, mentionné par wikipedia, me semble peu essentiel.
Après tout, ce livre est peut-être plusieurs choses à la fois. Tel un grand roman.
(Montréal, 14 mai 2024)